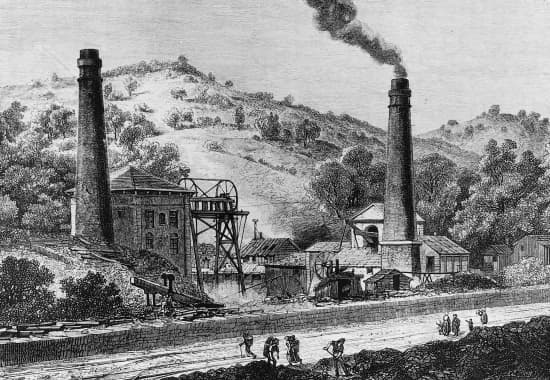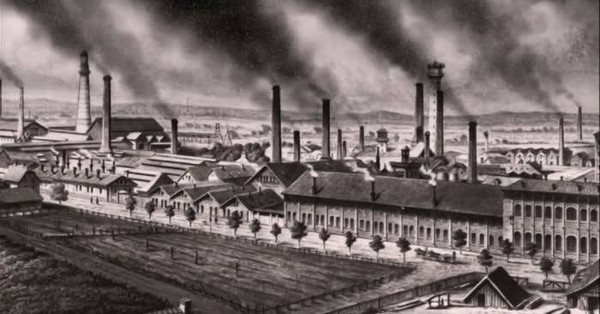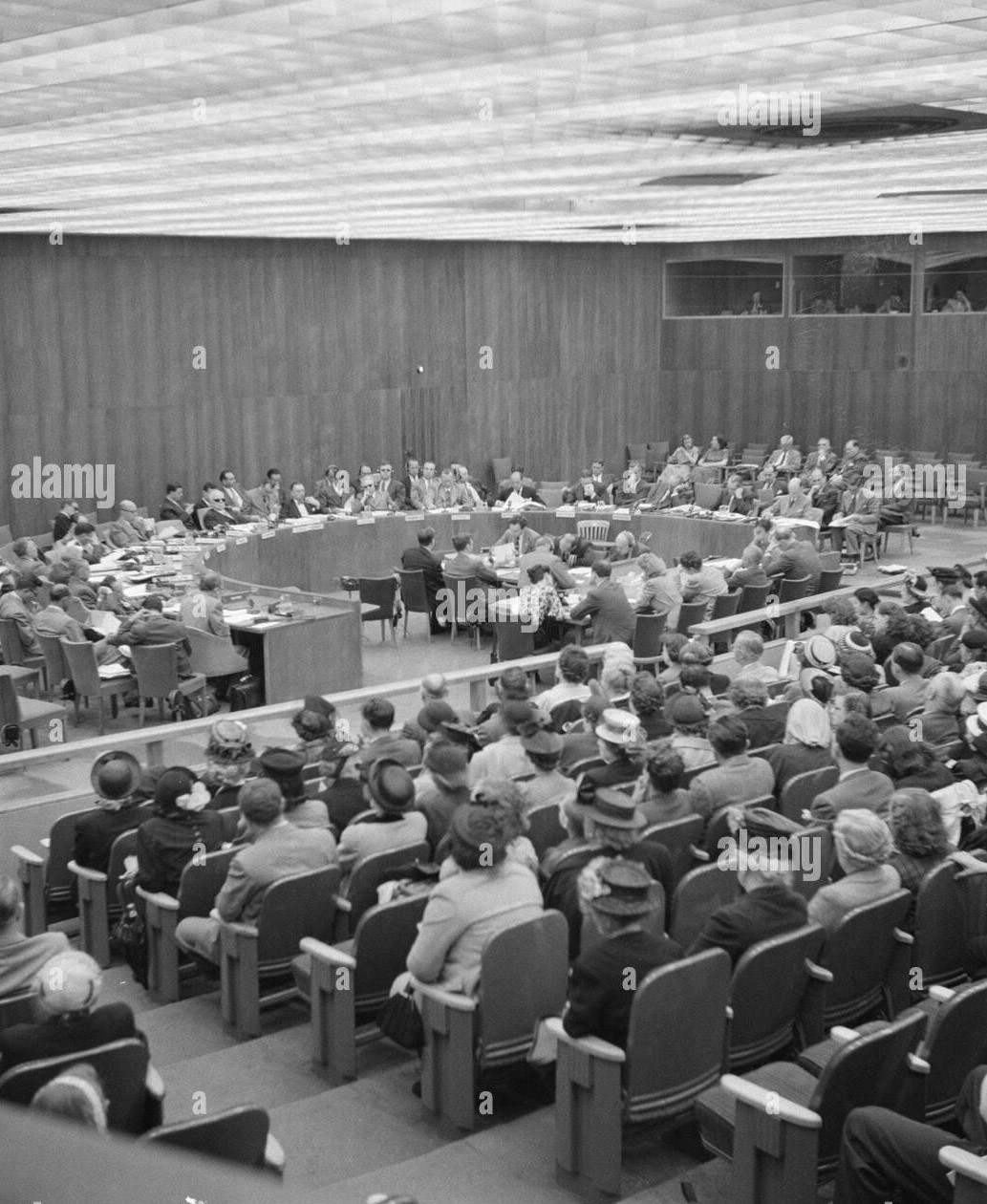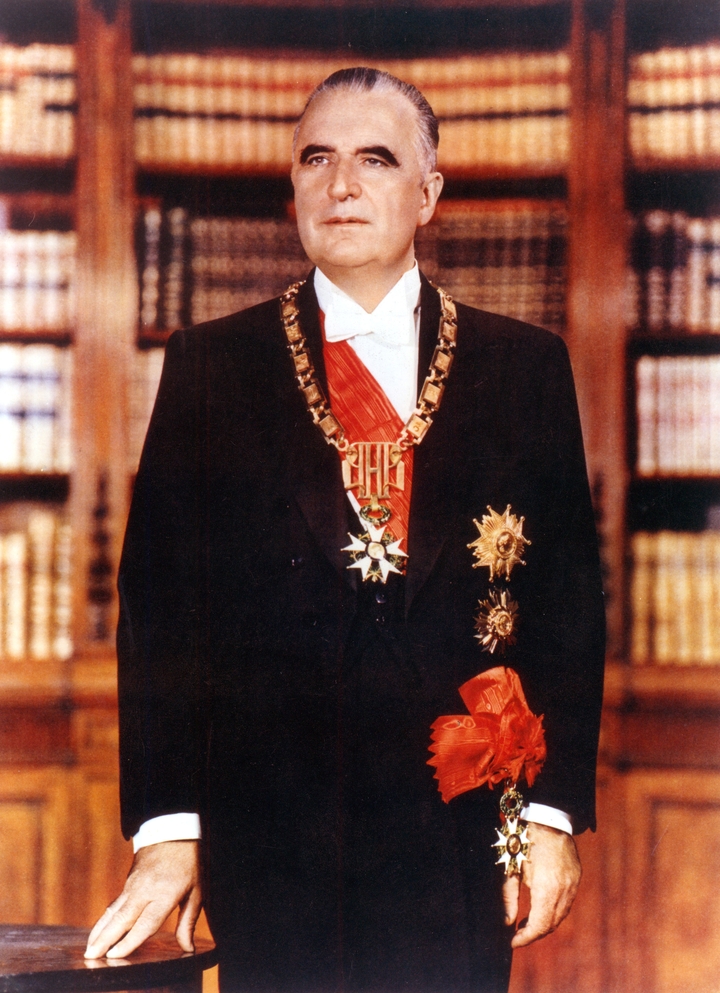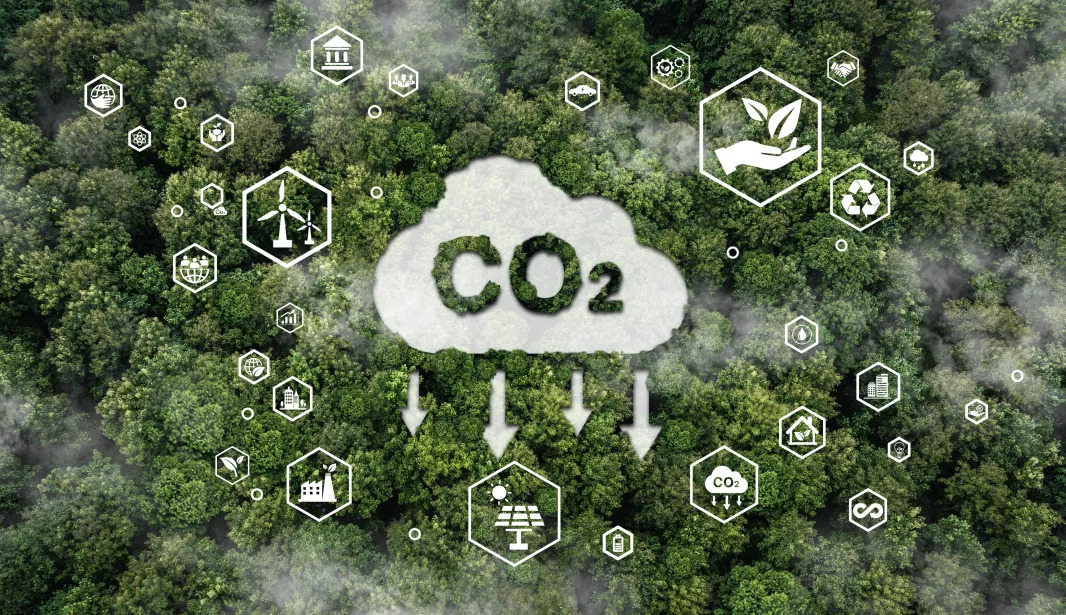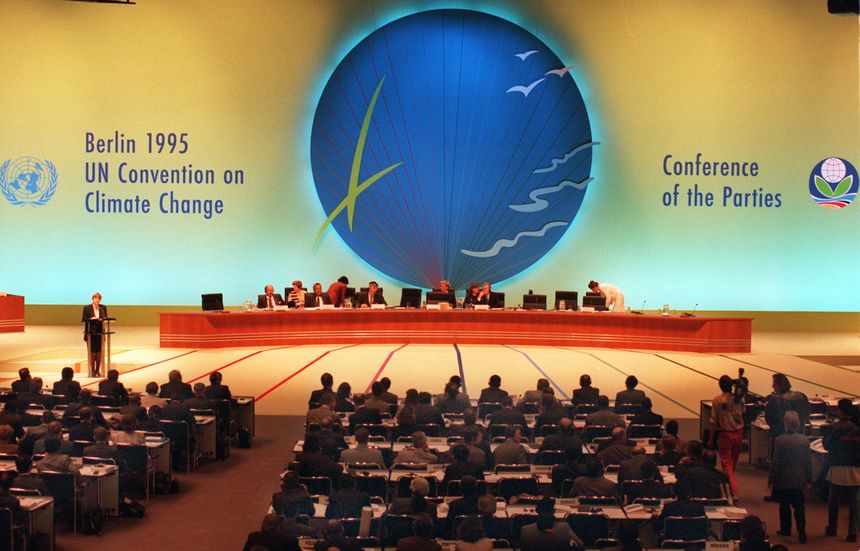Les ressources naturelles mises à rude épreuve.
La consommation de ressources naturelles a triplé en cinquante ans, et si cette tendance persiste, elle pourrait augmenter de 60 % d'ici 2060. Une telle hausse risquerait de rendre impossible la limitation du réchauffement climatique à 2 °C et d'aggraver l'effondrement des écosystèmes essentiels à notre survie. Inger Andersen, directrice exécutive du programme de l'ONU pour l'environnement, souligne l'urgence de changer radicalement nos modes de consommation, qui sont à l'origine de crises climatiques, environnementales et de pollution.
L'eau, bien que présente à 72 % sur Terre, est une ressource précieuse, car seulement 3 % de cette eau est potable. Cette eau est répartie entre les eaux de surface (lacs, bassins hydrographiques), les nappes phréatiques et les glaciers. Certaines régions, notamment les zones arides d'Afrique, d'Asie centrale et des Amériques, souffrent de stress hydrique, avec des disponibilités inférieures à 1 700 m³ par habitant. La demande d'eau augmente en raison de la croissance démographique et de l'expansion des terres agricoles irriguées, notamment dans les pays émergents. Les pays développés consomment plus d'eau que les pays en développement, à la fois pour l'agriculture, l'industrie et les activités domestiques. La gestion de l'eau est complexe, car elle peut entraîner des conflits internes et internationaux, notamment dans des pays comme l'Espagne, où les tensions entre les secteurs agricole et touristique sont de plus en plus fréquentes. De plus, les ressources en eau sont souvent polluées, et la pollution de l'eau est responsable de 2,2 millions de morts par an, en particulier dans les pays pauvres où les infrastructures d'assainissement manquent.
Les énergies qui impacte la stabilités des écosystèmes et de la nature
Le pétrole, source majeure d'énergie fossile, est utilisé principalement pour les carburants et la pétrochimie. Son exploitation, bien que très rentable, entraîne des pollutions importantes, notamment des marées noires, la destruction des écosystèmes et des émissions de gaz à effet de serre. Malgré ses impacts négatifs, l'industrie pétrolière reste l'une des plus rentables du monde, avec des gisements majeurs au Venezuela, en Arabie Saoudite et au Canada. En 2021, le pétrole représentait 30 % de l'énergie primaire mondiale.
Le changement climatique impacte également l'agriculture, avec une intensification des événements météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur et les sécheresses. Ces phénomènes réduisent la productivité agricole, avec des pertes de récoltes considérables. Le GIEC estime que 8 % des terres agricoles deviendront inadaptées au climat d'ici 2100, ce qui met en péril la sécurité alimentaire. En Europe, les pertes agricoles dues aux vagues de chaleur et aux sécheresses ont triplé en 50 ans, et des cultures essentielles comme le maïs, le soja, le riz et le blé sont déjà affectées. L'adaptation de l'agriculture face à ces changements inclut la diversification des cultures, le maintien de prairies et d'infrastructures agroécologiques (haies, arbres), et l'utilisation de couverts végétaux pour protéger les sols. Ces pratiques renforcent la résilience face aux aléas climatiques et améliorent la qualité des sols, leur capacité à retenir l'eau et leur biodiversité.
Face à ces défis, il est crucial de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre, dont l'agriculture est un contributeur majeur. Une transformation des pratiques agricoles et une gestion plus durable des ressources naturelles sont essentielles pour faire face aux impacts du changement climatique et garantir un avenir plus sûr pour la planète et ses habitants.